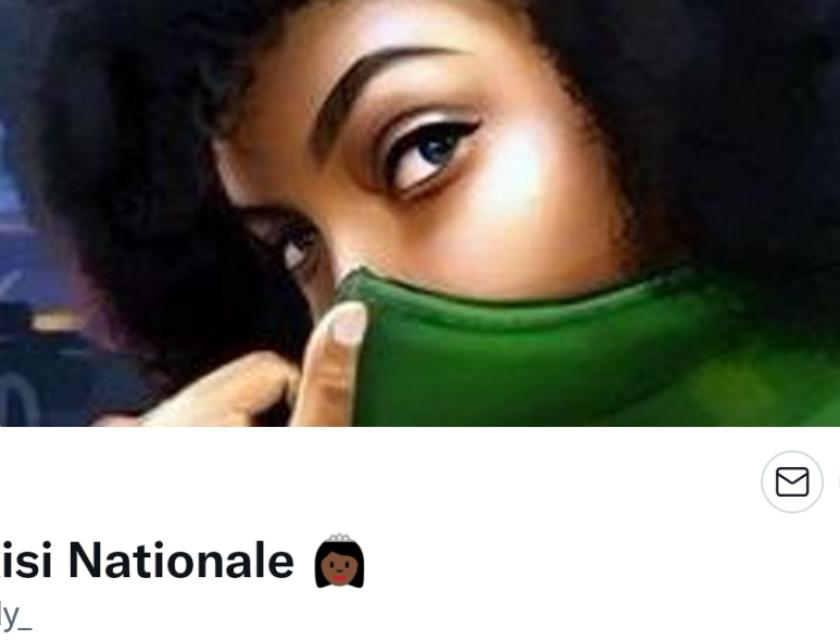Après les propos de Lord Lombo jugés dégradant envers la race noire, deux concepts se sont glissés dans le lexique des internautes congolais : « Négrophobie » et « Colorisme ». Deux concepts qu’on entendait pas trop mais qui sont, depuis le week-end dernier, au cœur même de ce scandale dont tout les internautes parlent. Que veulent dire ces deux concepts et quel contexte historique justifie leur apparition ? Éléments de réponse dans cet article.
La Négrophobie est issue de deux mots qui eux-même viennent de deux langues : du latin niger qui signifie noir et du grec phobos qui veut dire peur. Étymologiquement, la « négrophobie » renvoie à la peur de ce qui est noir. Cette définition étymologique ne s’applique cependant pas dans le contexte du scandale Lord Lombo. Pour comprendre le sens que revêt le concept « négrophobie » dans cette affaire, il faut revenir à la conception coloniale des rapport entre la race noire et blanche. La construction idéologique de l’époque consacrait une supériorité de la race blanche sur la race noire1. Cette conception n’est pas seulement restée idéologique, elle est aussi devenue sociale et s’est traduit de la plus belle manière par la traite négrière. Aujourd’hui encore plusieurs personnes estiment que la « négrophobie » se poursuit au travers des récits historiques partisans qui continuent à faire la part belle aux présupposés racistes de la « la suprématie blanche ».
Le concept « négrophobie » prend une forme de militante lorsqu’en 2005 en France, Zyed Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, deux adolescents africains meurent électrocutés dans un transformateur électrique où ils s’étaient abrités alors qu’ils étaient poursuivis par la police, soupçonnés d’un vol - non confirmé par la suite. La brigade anti-négrophobie (BAN) va naître à la suite de cette tragédie, puis un peu plus la la ligue La Ligue de défense noire africaine (LDNA), celle qui s’est fortement illustrée dans la lutte pour l’annulation du concert de Lord Lombo à Paris.
Le colorisme lui est un terme qui a été popularisé par Alice Walker, écrivaine afro-américaine auteure du roman La Couleur Pourpre (1982). Alice évoque le colorisme dans son recueil des poèmes Search of Our Mother’s Garden (1983). Dans ce recueil de 36 poèmes, Alice y définit le « colorisme » comme un traitement de faveur auxquels sont confrontées les personnes d’une même race basée uniquement sur leur couleur de peau. Cette tendance est héritée de l’époque de l’esclavage où, les Noirs à la peau la plus foncée étaient forcés de travailler dans les conditions les plus ardues tandis que ceux à au teint clair étaient autorisées à effectuer des tâches dans la maison des esclavagistes. L’industrie cosmétique a aussi contribué à propager la notion du « colorisme » en faisant croire, aux femmes noires surtout, que plus elles ont une peau claire plus elles sont belles.
Bien avant Alice Walker, l’écrivain-psychiatre Martiniquais Frantz Fanon avait déjà abordé la question du colorisme dans son ouvrage Peau noire, masques blancs. Pour lui, le colorisme s’explique par le fait que « les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisations, le sentiment d’être inférieur, par mépriser leur culture, langue et peuple, et souhaitent du coup ressembler au colonisateur ».
Avec cet éclairage, l’on comprend un peu mieux pourquoi les propos de Lord Lombo sont à la fois jugés de coloristes et négrophobes.